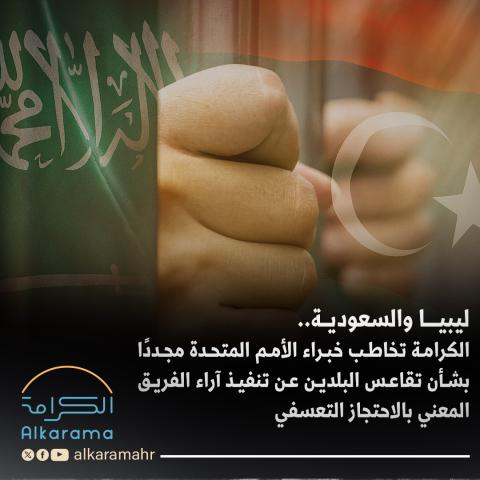
Dans un rapport de suivi adressé au Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (GTDA), Alkarama a dénoncé l’inaction persistante de la Libye et de l’Arabie saoudite quant à la mise en œuvre des avis rendus entre 2023 et 2025 concernant plusieurs cas de détention arbitraire.
En dépit des constatations des experts de l’ONU établissant de graves violations du droit à la liberté et appelant à la libération immédiate des victimes, à l’octroi de réparations et à l’ouverture d’enquêtes indépendantes, aucune mesure n’a été engagée. Les familles, seules sources d’information face au silence des autorités, confirment la persistance de violations systématiques : détentions prolongées sans inculpation ni procès, conditions carcérales inhumaines, privation de soins médicaux et absence totale de garanties judiciaires.
La Libye : L’arbitraire institutionnalisé
En Libye, le cas emblématique d’Abdurrahman Abduljalil Mohamed Al-Farjani, arrêté à l’âge de 17 ans et détenu sans jugement depuis 2014, illustre l’incapacité persistante de l’État à respecter ses obligations internationales. Malgré l’avis du Groupe de travail appelant à sa libération, il demeure incarcéré dans la prison d’Al-Koufiya près de Benghazi. La dégradation alarmante de son état de santé, due à l’absence de soins, reflète la dérive d’un système pénitentiaire qui piétine la dignité humaine et défie ouvertement le droit international.
L’Arabie saoudite : La dissidence criminalisée
En Arabie saoudite, plusieurs affaires emblématiques révèlent une volonté politique affirmée de réprimer toute dissidence et de museler les voix critiques. La répression frappe d’abord des figures religieuses de premier plan, comme Salman Alodah, incarcéré depuis plusieurs années. Privé de contact régulier avec ses proches et soumis à des restrictions arbitraires, il subit une violation flagrante de son droit à la vie familiale et à la communication.
Elle s’étend ensuite aux intellectuels et universitaires, tel que le Dr Awad Al-Qarni, détenu à l’isolement dans des conditions particulièrement éprouvantes et menacé de la peine capitale pour avoir exercé pacifiquement sa liberté d’expression sur les réseaux sociaux. Son cas illustre la criminalisation directe de l’opinion et du débat public.
La même logique répressive touche également des ressortissants étrangers, à l’instar de Bassam Al-Jalladi, citoyen yéménite détenu sans procès équitable. Privé de tout contact avec sa famille depuis plus d’un an, il se voit dénier à la fois ses garanties fondamentales de procédure et son droit à la dignité.
Enfin, l’affaire de Mohsen Al-Awlaqi confirme l’instrumentalisation du système judiciaire à des fins répressives. Sa condamnation, même partiellement révisée en appel, prononcée en méconnaissance des droits essentiels à un procès équitable, illustre l’exploitation du système judiciaire pour conférer une apparence de légalité à l’arbitraire des autorités royales.
Un défi lancé au droit international
Ces situations, loin d’être des « cas isolés », révèlent un schéma systématique de violations traduisant un mépris assumé du droit international et des obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). En refusant de mettre en œuvre les avis du Groupe de travail, la Libye et l’Arabie saoudite portent atteinte non seulement aux droits fondamentaux des victimes, mais aussi à la crédibilité même du système multilatéral de protection des droits humains.
Alkarama souligne que l’absence de coopération des États concernés constitue un affront direct aux mécanismes internationaux et prolonge inutilement les souffrances des victimes.
À travers son rapport de suivi, Alkarama a exhorté le Groupe de travail à enjoindre les États à libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues arbitrairement, à rappeler aux autorités leurs obligations internationales et à promouvoir des réformes structurelles afin de prévenir la répétition de telles violations.
